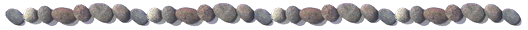

Bienvenue sur la page de l'Atlas linguistique de la Polynésie française. Fruit d'une décennie de collaboration entre deux linguistes du CNRS – Jean-Michel Charpentier(†) et Alexandre François – ce volume de 2562 pages se veut un ouvrage de référence sur la diversité des langues et dialectes de la Polynésie française.
Charpentier, Jean-Michel & Alexandre François. 2015.
Atlas Linguistique de la Polynésie Française — Linguistic Atlas of French Polynesia.
Berlin, Papeete : Mouton de Gruyter & Université de la Polynésie Française. 2562 pp. (ISBN : 978-3-11-026035-9)
Inauguré en février 2015, l'atlas est publié conjointement par l'Université de la Polynésie française (UPF) et par l'éditeur scientifique De Gruyter. Les auteurs et les éditeurs ont souhaité conjointement que ce travail soit distribué gratuitement, en Accès libre, afin de profiter à tous. N'hésitez donc pas à le télécharger et à le diffuser !
Parmi les langues du Pacifique, mon travail de linguiste est spécialisé dans la Mélanésie, en particulier Vanuatu et îles Salomon. Quant à la famille polynésienne – le plus célèbre des groupes linguistiques parmi les langues océaniennes – elle m’a certes toujours intéressé, mais indirectement, comme un cousin lointain qui nous intrigue, mais que l'on ne connaît pas si bien. Parmi mes recherches de terrain, la seule langue polynésienne que j'avais eu l'occasion d'explorer de première main était le tikopien (ou fakatikopia), langue de Polynésie extérieure, parlée à l'est des îles Salomon.
Pourtant, même si elles étaient peu représentées dans mon propre travail de terrain, les langues polynésiennes occupent depuis quelques années une place particulière dans ma recherche. En 2004, mon collègue Jean-Michel Charpentier m'a proposé de collaborer avec lui à un projet d'atlas linguistique, projet que j'ai tout de suite accepté — tant j'ai toujours été fasciné par la géographie linguistique et la dialectologie, cet art de dessiner un paysage à travers les mots.
À l'initiative de Mme Louise Peltzer, alors Ministre de la Culture du gouvernement de la Polynésie française, Jean-Michel a relevé le défi de documenter une vingtaine de variétés linguistiques disséminées dans les divers archipels de Polynésie. Entre 2004 et 2010, il a entrepris un travail colossal de recueil de données sur le terrain, qui l’a conduit à voyager d’île en île, à la recherche des bons locuteurs des parlers locaux. Ses enquêtes consistaient à remplir un immense questionnaire lexical de sa conception, sorte de dictionnaire onomasiologique et thématique composé de 2250 entrées. Ce faisant, Jean-Michel a également bénéficié du soutien de nombreux locuteurs et connaisseurs de ces langues, académies et associations de gens passionnés par la préservation de leur patrimoine linguistique.
Dans un second temps, Jean-Michel m’a transmis ses 2000 pages de notes de terrain : mon rôle était alors de transformer ces données brutes en un atlas linguistique. Entre 2009 et 2014 (en parallèle avec mes recherches sur la Mélanésie), j’ai ainsi conçu le format définitif de cet atlas, écrit un script de cartographie dynamique, et généré, l’une après l’autre, les 2253 cartes de l’atlas. Outre les cartes elles-mêmes, j’ai également créé 200 pages d’index en trois langues (français, anglais, tahitien), et 120 pages de chapitres introductifs (en français et en anglais). Tout en me chargeant des relations avec les éditeurs De Gruyter et l’U.P.F., j'ai enfin pu créer l’ensemble de l’ouvrage en prêt-à-clicher.
Il s’agit donc bien là d’un véritable travail de collaboration au long cours, entre ses deux auteurs. Retraité en 2010, Jean-Michel Charpentier a eu la satisfaction de voir notre ouvrage prendre belle tournure, à mesure que je lui montrai les cartes et les chapitres que j’avais réalisés à partir de ses données. Malheureusement, j’ai appris la triste nouvelle de son décès, le 30 mars 2014 – alors que notre ouvrage entrait dans sa phase ultime de préparation. Aujourd’hui que notre atlas voit enfin la lumière du jour, je pense à mon collègue et ami Jean-Michel, qui peut être fier du travail que nous avons accompli ensemble.
(Les premières pages du volume publié présentent un hommage à Jean-Michel Charpentier, et à son œuvre scientifique.)






